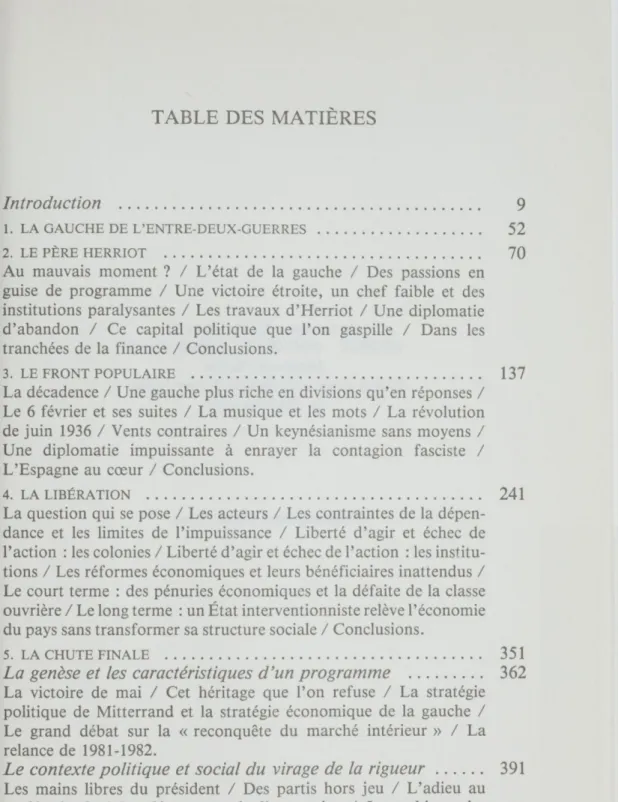SISYPHE EST FATIGUÉ
DU MÊME AUTEUR
A L'AMÉRICAINE, faire u n Président Aubier, 1986
SERGE HALIMI
SISYPHE
EST FATIGUÉ
Les échecs de la gauche au pouvoir 1924, 1936, 1944, 1981
ROBERT LAFFONT
@ Éditions Robert Laffont, S.A., Paris, 1993 ISBN 2-221-07309-6
Hommes pour qui ce trésor fut chanté Hommes pour qui ce trésor fut gâché.
Paul Eluard, Cours naturel (1938) Tous les mouvements dont le peuple a pris l'initiative ont donné le contraire de ce que le peuple en attendait.
Léon Blum, 1892
INTRODUCTION
« La trace d'un rêve n'est pas moins réelle que celle d'un pas. »
Georges Duby La gauche a exercé le pouvoir quatre fois dans ce siècle.
Chaque fois, l'exercice a été plutôt bref. Une année en 1924, guère plus en 1936, moins de trois ans à la Libération, cinq ans entre 1981 et 1986 avant que les catégories politiques ne se brouillent, peut-être pour longtemps. Même si la tendance est à la hausse, ces passages représentent à peine plus qu'une décennie en soixante- dix ans d'histoire, petits cailloux d'« expériences » de gauche éparpillés sur une route construite et balisée par la droite. Dans un pays où le score électoral du « Parti du mouvement » est rarement descendu au-dessous de 45 % et a souvent atteint la majorité relative, on est en droit de s'interroger sur les raisons du mariage difficile entre la gauche et le pouvoir. Pourquoi fut-il si rare ? Pourquoi fut-il si bref ? Pourquoi fut-il si décevant ?
La distinction tranchée entre droite et gauche a, pendant près de deux siècles, constitué le décor d'une scène sur laquelle se sont affrontées de vraies émotions pour lesquelles on s'est battu avec férocité et dont on s'est souvenu avec ferveur. A intervalles presque réguliers, le conflit opposant la société traditionnelle de l'Ancien Régime au nouveau monde né de la Révolution a refait surface, chaque camp connaissant à merveille chacun des antécédents qu'il lui conviendrait de ressusciter et chacun des
symboles qu'il allait lui falloir abattre. Dans l'ensemble, la gauche l'a emporté lorsqu'il s'est agi de se forger une identité culturelle, une vision de l'histoire, une lignée de héros. La droite, elle, s'est contentée de gouverner la France. Avec beaucoup de sens pratique, elle a abandonné le romantisme à ses adversaires et s'est affairée à servir les intérêts qu'elle représentait. En restant au pouvoir, elle les a bien servis. Pendant que d'autres se disputaient le ministère des Idées, elle occupait le ministère des Finances. Une histoire de la droite française et de l'exercice du pouvoir n'aurait dès lors guère de sens : à l'exception d'interludes aussi brefs qu'épars, la droite française a été le pouvoir.
Le morne bilan de ces interludes amène à s'interroger : Comment la gauche qui mobilise si bien parvient-elle à gouverner si peu et à décevoir si vite ? Pourquoi se perd-elle si souvent entre les révolutions qu'elle prospecte, les réformes qu'elle promet et les reculs qu'elle provoque ? Dans le contexte actuel, les réponses vont au-delà d'un simple rappel de l'histoire ou d'un médiocre règlement de compte. Elles permettent de comprendre le remaillage de la politique française très loin de ses pesanteurs traditionnelles.
Cette grande transformation tient en effet beaucoup aux « leçons » tirées par la gauche de son exercice du pouvoir. Incapable de soutenir aux affaires l'élan provoqué par son discours révolution- naire, la gauche perd le soutien de son électorat et prépare le retour de la droite. Lorsque, au contraire, elle reconnaît l'étendue des contraintes qui s'opposent à ses projets, lorsqu'elle adapte son programme aux objectifs modestes qu'elle peut atteindre sans combat, lorsqu'elle se contente de dessiner un tout petit « plus » sur le statu quo dont elle hérite, la gauche facilite son maintien au pouvoir, mais le fait au prix de l'abandon de son héritage, de la démobilisation de ses alliés comme de ses adversaires, et d'une transformation de la France en une longue rivière tranquille qui cesse d'intéresser le monde dès lors qu'elle cesse de le déranger.
La navigation est dure entre ces deux récifs : un discours du changement que submergent les contraintes du monde réel, une pratique de gouvernement qui corrode les justes clivages du politique. Ambitions déçues ou modernité factice ? « Expériences » qui échouent ou « Fin de l'histoire » ?
La problématique qui sous-tend ces questions est loin d'être spécifique à la France ou propre à la gauche. La tension entre appel au peuple et recours aux experts, mobilisation charismatique
et gestion gouvernementale, poésie de l'histoire et prose du pouvoir est l'un des thèmes majeurs que se disputent philosophes et écrivains, sociologues et historiens, le Max Weber de Science et Politique et le Stendhal de Lucien Leuwen. Mais, depuis 1789, la
France a en ces matières souvent servi de laboratoire au monde.
Deux siècles après son déroulement, la Révolution française reste un sujet de controverse entre gauche et droite. Cette dernière persiste à s'interroger sur sa nécessité et à mettre l'accent sur son
« coût1 » à moins qu'elle n'ait la témérité suffisante pour exprimer un certain malaise devant l'intrusion des masses dans l'histoire et l'émergence du concept d'égalité au fronton de la culture politique française. Pour la gauche, bien sûr, la prise de la Bastille par le peuple de Paris a représenté une naissance symbolique, celle d'une tradition révolutionnaire, tantôt évoquée avec entrain, tantôt chantée comme un requiem. Les symboles politiques issus de l'histoire et maintenus vivants par la mémoire collective construi- sent une somme d'images et d'aspirations qui résistent souvent aux transformations de l'économie et de la société. Marx lui-même a défini l'émergence d'une classe comme le creuset d'une condition économique et d'une culture, d'une catégorie sociale et d'une conscience. Il est important de conserver cette dualité à l'esprit ne serait-ce que pour comprendre pourquoi les chefs de la gauche, au demeurant souvent issus de la bourgeoisie, se sont montrés si désireux de rappeler la geste des sans-culottes et l'image des têtes qui tombent alors même qu'ils relevaient le défi de faire fonctionner une économie capitaliste moderne. La difficulté de réconcilier l'un avec l'autre allait se manifester avec fracas chaque fois que se présenteraient les responsabilités du pouvoir mais, en attendant ou dans l'intervalle, les références charismatiques de la gauche continuaient de peser de leur poids de légendes. Tocqueville l'a noté : « Les établissements politiques sont comme les religions, où le culte survit d'ordinaire longtemps à la croyance 2. » Dans le cas qui nous occupe, le culte et la foi ont tardé à s'éteindre. C'est leur rendement qui s'est affaissé dès lors que les incantations et 1. Voir René Sédillot : Le Coût de la Révolution française, Paris, Perrin, 1987.
2. Alexis de Tocqueville : L'Ancien Régime et la Révolution, Bouquins, Robert Laffont, 1986, p. 1113.
les prières se soldaient par autant de revers. Au fond, peu importait : la gauche française ne se voulait pas religion utilitaire.
Pourtant sa présence resta puissante. Le radicalisme dont elle se faisait l'avocat soulevait les esprits à défaut d'équilibrer les comptes. Dans un contexte qui privilégiait les vraies émotions, le conflit, plus que le compromis, dominait le paysage. Pour le peuple de gauche, la politique avait d'autres enjeux que la redistribution des revenus. Elle fondait une culture commune, celle du rejet passionné d'un ennemi qui incarnait tout à la fois Thermidor, la restauration monarchique, la répression de juin 1848, l'écrasement de la Commune, la réaction cléricale et Vichy. Le débat civique se voyait immanquablement doublé d'une communion au cours de laquelle on exorcisait les maléfices, au demeurant bien réels, de l'adversaire. La lutte des classes procurait ses gratifications psychologiques, celles-là mêmes que redoutait tant Max Weber, « la satisfaction de la haine et l'impatience de la revanche ». Du berceau au cercueil, les choix politiques ne se modifiaient guère : on ne se fabrique pas de vieux camarades.
Aux États-Unis, les présidents démocrates peuvent faire référence au républicain Lincoln et les présidents républicains aux démocrates Roosevelt ou Kennedy. En France, personne n'attendait de la droite et de la gauche qu'elles se réconcilient autour d'un mont Rushmore sur lequel auraient figuré côte à côte les visages de Jaurès et de Mac-Mahon. Quelles sont, aujourd'hui encore, les municipalités de droite qui inaugurent des avenues Robespierre ou les municipalités de gauche qui créent des squares Adolphe- Thiers ? Les revenus peuvent progresser et le nucléaire supplanter le charbon, ces cultures politiques perdurent et définissent qui est où et qui dit quoi. Apparemment imperméables aux autocritiques et aux aggiornamentos des « responsables », des régions entières ont d'ailleurs continué à voter de la même manière depuis deux siècles ; le socialisme de la Ve République a puisé sa source électorale dans le vivier du républicanisme jacobin.
Lorsqu'un changement de camp ou d'avis est interprété comme une trahison ou comme un reniement, il est tentant de parler de manichéisme. Et il est courant d'imputer à ce manichéisme toutes sortes d'artérioscléroses, « société bloquée » ou « mal français ». C'est oublier un peu vite le rôle bénéfique joué par les passions politiques et leur confrontation. Elles ont transformé des
spectateurs cyniques en acteurs de leur propre épopée et ont contribué ainsi à cet essor de la participation civique qui constitue souvent la garantie d'une bonne vie démocratique. Même Tocque- ville, qui ne goûtait guère l'arrivée de la plèbe sur la scène Mitique, décrivit les émotions suscitées par la révolution de 1789 comme « une croyance admirable qui nous manque... une sorte de religion nouvelle qui, produisant quelques-uns des grands effets qu'on a vu les religions produire, arrachait les Français à l'égoïsme individuel, les poussait jusqu'à l'héroïsme et au dévouement, et les rendait souvent comme insensibles à tous ces petits biens qui nous possèdent1 ». Une telle métamorphose ne peut pas se comprendre indépendamment des combats politiques dont elle fut la conséquence. Un débat technocratique opposant entre elles deux visions modérées du monde provoque rarement ce degré de mobilisation et cette ardeur des loyautés qui se sont retrouvés à travers l'histoire de France. Le désarroi d'aujourd'hui, le recroquevillement de l'individu dans l'individuel, le règne de l'éphémère et du vulgaire doivent beaucoup au fait que, deux siècles après 1789, la Révolution a été expulsée de la politique française comme un squatter qui aurait atteint son seuil de tolérance.
Il est plus facile de gouverner dans ce nouvel univers que les masses abandonnent aux experts et où le « possible » remplace le
« nécessaire ». Avant 1981, seule la droite, presque continuellement au pouvoir, insistait sur les contraintes de l'économique, alors que la gauche, presque toujours dans l'opposition, mettait l'accent sur la morale du politique. A sa manière, la gauche était moins hypocrite (tout n'était pas factuel dans les « contraintes » qu'on opposait à ses velléités de réforme), mais elle prenait davantage de risques. Elle s'obligeait à devoir soutenir au pouvoir l'élan que son idéalisme avait soulevé et qui la placerait en position de décevoir. Tant que la gauche s'installait dans l'opposition, le risque demeurait théorique. Dès lors, contemplant ses tendances autodestructrices, certains n'ont pas manqué de mettre en cause le comportement doctrinaire de ceux qui préfèrent une jolie défaite à un morne compromis. Parlant de 1789, Tocqueville fit mine de déplorer que l'aveuglement de la passion ait fait obstacle aux principes que les jacobins entendaient voir triompher. Sous sa
1. A. de Tocqueville, op. cit., p. 1046.
plume, la remarque était un peu cauteleuse. Lorsque, deux ans après 1848, Tocqueville tremble encore de peur et de rage en pensant aux journées de juin, ses écrits sur le soulèvement parisien ont un ton moins détaché que son analyse de l'Ancien Régime.
Et, en général, les proclamations contre-révolutionnaires ne furent guère moins enflammées que celles de la gauche, à cette différence près que, dans le premier cas, les actes ressemblaient aux mots.
On peut se demander pourquoi la France a mis si longtemps à se fondre dans le moule à la fois annoncé et redouté par Max Weber, celui d'une politique « dé-humanisée » qui évincerait des affaires publiques « l'amour, la haine et tous ces éléments personnels, émotionnels et irrationnels qui échappent au calcul1 ».
Ce résultat — que certains assimilent à une réussite — allait dépendre de la déradicalisation de la gauche française, conséquence à la fois récente et sans doute irréversible de son exercice du pouvoir. Jusqu'en 1981, les socialistes et les communistes pouvaient encore incorporer leurs références révolutionnaires dans le corpus de leurs programmes politiques. L'élection de François Mitterrand a obligé la gauche à tenter de gouverner sur la base d'une idéologie dont l'impact mobilisateur était fort mais qui n'avait pas prouvé son efficacité administrative. D'autres gouvernements de gauche avaient précédé celui de 1981, d'autres gouvernements de gauche avaient déçu, mais, chaque fois, leurs environnements institution- nel, économique et politique les ont rendus impropres à tout jugement définitif ; l'échec pouvait être imputé à des circonstances exceptionnelles : expériences trop brèves pour être concluantes, guerre qui menace (1936) ou dont on doit apurer l'héritage (1924, 1944). En 1981, en revanche, la gauche a dirigé un pays moderne dans un contexte « normal ». Cette fois-là, l'appréciation de sa performance allait permettre de déterminer dans quelle mesure l'ancienne culture politique serait confortée ou consumée. Et puisque cette culture, ce radicalisme, avaient contribué à la polarisation politique française, une embardée idéologique de la gauche ne pourrait manquer de provoquer de sérieux remous.
En dehors du fait que le défi réel vint si tard, d'autres facteurs ont expliqué l'utilisation par la gauche de ces « éléments 1. Max Weber : Essays in Sociology, Oxford University Press, 1980, p. 216.
émotionnels qui échappent au calcul ». D'abord, il faut reconnaître qu'une position intransigeante insistant sur la nécessité d'une révolution dans l'ordre social n'était pas aussi « irrationnelle » que cela, aussi longtemps que la droite refusait avec morgue dialogue ou négociation. Du début de la révolution industrielle à 1936, le monde du travail fut systématiquement ignoré par les milieux d'affaires et par l'État sauf lorsqu'en période de révolte il était réprimé avec force. Soixante-cinq ans après le bain de sang de la Commune, Simone Weil pouvait encore relever dans les usines la permanence d'« un certain ordre, une certaine discipline basée sur l'esclavage »... On est au monde pour obéir et se taire.
Que, dans un contexte pareil, le ressentiment d'un outrage teignît des couleurs de la colère la prise de conscience d'une iniquité, que l'ensemble accouchât d'un climat dans lequel la grève et la guerre l'emportaient souvent sur le compromis et le contrat, ne justifient guère les commisérations rétrospectives des adorateurs de l'apaise- ment. La contradiction explosive entre citoyenneté politique et soumission économique ne pouvait en effet que susciter un débat amer portant sur la signification et sur l'impact du mot République.
Cependant, ni la Révolution française ni l'idéologie des partis de gauche n'ont été inspirées par la classe ouvrière. A la différence de l'Allemagne et de l'Angleterre, pour ne citer que ces deux exemples, le monde du travail, institutionnellement faible et infiniment divisé, a rarement pris en charge la direction des affaires de la gauche. Des intellectuels progressistes ont suppléé à cette absence — à moins qu'ils ne l'aient provoquée en occupant tout le terrain. A la manière prescrite par Lénine, ils se sont arrangés pour diriger le mouvement ouvrier loin des ornières supposées de toute « conscience syndicale » et vers une prise de « conscience révolutionnaire ». Les analyses des « passions révolutionnaires » développées par Tocqueville ou par Max Weber ne diffèrent guère de celle qu'on découvre dans Que Faire ?, même si, à la différence de Lénine, ces passions sont déplorées à la fois en raison de leur charge affective (Weber parle d'un « carnaval qui embraie sur du vide, totalement dépourvu du sens objectif des responsabilités 1 ») et, surtout dans le cas de Tocqueville, de leur contenu révolution- naire. Reste que les trois auteurs s'accordent pour estimer qu'une analyse intellectuelle de l'oppression est plus susceptible de débou-
1. M. Weber : op. cit., p. 115.
cher sur des conclusions radicales que l'épreuve quotidienne de cette oppression. Ainsi, Tocqueville assimile les « passions révolutionnaires » à « l'introduction de l'esprit littéraire en politi- que ». Et il explique : « Dans l'éloignement presque infini où les écrivains vivaient de la pratique, aucune expérience ne venait tempérer les ardeurs de leur naturel ; rien ne les avertissait des obstacles que les faits existants pouvaient apporter aux réformes même les plus désirables 1. » Le diagnostic donne le ton de ce que seraient les récriminations conservatrices : intellectuels subvertis- sant le système par leur « nihilisme apocalyptique » lorsqu'ils ne légitiment pas carrément le recours aux « cocktails Molotov ».
Cette mise en cause eut, bien sûr, un caractère polémique : comme la gauche, la droite aimait assez se sentir encerclée par des comploteurs ; les penseurs qui se mêlaient de politique ne la gênaient que lorsqu'ils avaient le caprice de mettre en cause le système et les intérêts économiques auxquels elle était pour sa part résolument attachée. Néanmoins, comment nier le rôle que les intellectuels français ont joué lorsqu'il s'est agi de radicaliser le discours de la gauche ? Et dans la mesure où leur langage charismatique fut perçu comme trop extrémiste par des groupes sociaux (les classes moyennes) dont toute victoire électorale dépendait, cette radicalisation peut bien avoir perpétué le pouvoir de la droite et cette division du travail évoquée par Tocqueville :
« Aux uns la conduite des affaires ; aux autres, la direction des intelligences2. » La boucle semble ainsi bouclée : parce qu'ils n'ont pas compris les contraintes du pouvoir, les intellectuels progressistes ont rêvé au nom de la gauche ces formules impossibles qui interdirent à la gauche d'accéder au pouvoir. Bien sûr, le syllogisme est ici trop parfait. Il ne nous autorisera pas à faire l'économie d'un inventaire de ce qui était « possible » et ne fut pas entrepris.
Lorsque les gens crient très fort, c'est parfois qu'il y a loin entre l'endroit où ils se trouvent et celui où le pouvoir réside : il faut élever la voix pour être entendu. Ici, le « loin » n'est pas géographique : la plupart des révolutions sont parties de Paris, pas des provinces. La centralisation a facilité la transformation d'émeutes parisiennes en révolutions dans la mesure où elle a
1. A. de Tocqueville : op. cit., p. 1036.
2. Id., Ibid., p. 1040.
concentré les sources — et donc les cibles — du pouvoir. Mais si l'État et la fraction la plus radicalisée des masses (des sans-culottes à la « ceinture rouge ») ont vécu côte à côte, cette proximité tint davantage de la relation entre gardiens et détenus que du bon voisinage. L'absence de dialogue, autre qu'une « communication » coercitive, entre un État fort et une société faible a expliqué la nécessaire violence des éruptions qui altérèrent le statu quo. L'idée est bien connue des étudiants de Michel Crozier ou de Stanley Hoffmann : en France une insuffisance de réformes économiques a provoqué nombre de révolutions politiques. Les révolutions ont souvent abouti alors au type de mise à jour économique et sociale que toute interaction politique « normale » aurait suscité dans un contexte différent. A la lumière de ces expériences, une culture de la révolution pouvait apparaître rationnelle, étant à la fois charismatique et pragmatique. Certes, elle a rarement débouché sur le changement de système auquel elle prétendait aspirer, mais elle a permis de faire éclater la gangue de la « société bloquée ».
Par ailleurs, la centralisation a facilité l'essor d'un socialisme non démocratique en concentrant l'attention de chacun sur le pouvoir exécutif. La formation d'un noyau de « révolutionnaires profes- sionnels », qui pourrait s'emparer de l'État et ainsi faire marcher le pays, l'a emporté sur une approche gradualiste du changement social. Elle a également abouti, même si là le combat dura plus longtemps, à pulvériser les projets « utopistes » de ceux qui rêvaient de petites communautés et de fédéralisme. C'est parce que la France fut un pays où, selon l'expression de Marx, l'État était parvenu à devenir « complètement indépendant » de la société 1 que le blanquisme et le léninisme ont prospéré, et avec eux l'espoir d'un coup d'État réussi, seconde prise de la Bastille ou nouveau palais d'Hiver. Même si elles furent souvent déçues, ces veilles se répétèrent. Le grand soir avait parfois paru si proche (1919, 1936, 1944, 1968) qu'il ne pouvait qu'être reporté. Entre- temps, personne n'avait le droit de se satisfaire de moins qu'une victoire totale. Déjà irréaliste compte tenu de l'intransigeance du pouvoir, la démarche réformiste prit l'allure d'une trahison.
L'étendue de l'outrage social, la violence de la répression 1. Karl Marx : Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, Editions sociales, 1976, p. 126.
politique, le rôle des intellectuels et la cible attrayante d'un État centralisé ont ainsi contribué à la vigueur de cette tradition révolutionnaire grâce à laquelle la gauche sut mobiliser sa base électorale et militante. Le souci de la France de tenir son rang dans l'histoire et d'asseoir son prestige dans le monde a rendu presque imprenable cette tradition assaillie par les prophètes récidivistes de la « fin des idéologies ». Une certaine révérence pour un passé révolutionnaire somme toute plutôt glorieux a retardé la transition vers un modèle anglo-saxon de politique apaisée. Appris dès l'enfance, les poèmes d'Hugo inspirèrent des rêves de « va-nu-pieds superbes » marchant sur un « monde ébloui » et renforcèrent l'adhésion à une vision messianique de la France et de son histoire. Même à gauche, l'évocation des soldats de l'an II se transforma à l'occasion en une légitimation du colonialisme et de sa « mission civilisatrice ». Il faut d'ailleurs être juste : il n'était pas absurde de prétendre que la France avait plus d'une fois démontré l'uni ver salisme de son expérience nationale. De 1789 à 1848, elle transforma le visage de l'Europe ; elle détrôna des monarques et elle modifia des frontières pour des raisons qui n'étaient pas seulement imputables à l'intérêt égoïste d'un pays plus puissant que ses voisins. Alors qu'un siècle plus tard l'Union soviétique se résignerait assez vite au « socialisme en un seul pays », la France, de 1791 à 1815 et une fois encore en 1848, ne fit pas mystère de son désir de voir ses idéaux de liberté contaminer l'Europe entière. Même la restauration monarchique dût être imposée par des troupes étrangères, contribuant ainsi à une fusion entre les concepts du national et du révolutionnaire.
C'est parce que le patriotisme français symbolisait aussi la défense de principes universels que Goethe put se réjouir de la défaite des armées prussiennes devant Valmy, armées qui, il le savait, avaient pour objectif premier de détruire la démocratie et la république.
Bien plus tard, ce fut encore en France que des jeunes hommes en colère vinrent recevoir leur éducation révolutionnaire. Une fois au pouvoir, Hô Chi Minh, Kieu Samphan, Enver Hoxha et Chou En-Lai, pour ne citer que ceux-là, démontreront que ce qu'ils avaient appris à Paris n'était pas la géométrie du juste milieu.
C'est donc un thème persistant de la gauche que de Gaulle reprit à son compte lorsqu'il parla d'« un pacte vingt fois séculaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde ». Vingt siècles, la durée faisait penser à Robespierre pour qui le peuple français
avait, grâce à la Révolution, pris deux mille ans d'avance sur le reste du genre humain, à tel point qu'il constituait, désormais,
"ne espèce différente. Cette affirmation, que n'encombrait pas une modestie excessive, situait bien l'ambition et le défi de la gauche : il lui fallait rester fidèle à son héritage et, si cela signifiait perdre quelques batailles, le faire avec panache pour laisser à la postérité ces traces qui mériteraient d'être prospectées. Le présent s'insérait entre un passé de légende et les lendemains qui chantent ; une forme de romantisme parfois totalitaire imposait le refus quasi esthétique des méandres du compromis. Il y eut là autre chose qu'un thème de discours pour préau de partisans ; l'histoire était douce aux hommes de principes : comme le souligna un jour François Mitterrand (longtemps, il est vrai, avant de devenir lui- même chef de l'État) : « Qui se souvient des hommes qui furent présidents de la République pendant que Jean Jaurès n'était que responsable du Parti socialiste ? » Un pays exceptionnel comme la France se devait d'inspirer l'univers. Pendant que la gauche s'affairait à la tâche, la droite continuait de gouverner. Les choses commencèrent à changer lorsque, selon les mots ironiques de Sartre, « la capitale du Monde » prit finalement conscience qu'elle était devenue « chef-lieu de canton 1 ». Le panache révolutionnaire devient alors un peu dérisoire. Le monde regarde ailleurs ; il constate que les idéologies qui assignent un sens à l'histoire se décomposent et s'écroulent.
Il y eut bien sûr des moments, et ce sont ceux qui nous intéressent, pendant lesquels la gauche française cessa de n'être qu'une présence morale respectée pour ses convictions et devint l'autorité légale que l'on devait reconnaître. Assurément significa- tive, la transition n'impliquait pas forcément un reniement ou une rupture : on peut aller vers l'idéal sans ignorer le réel ; une
« éthique de la responsabilité » n'impose pas un pragmatisme sans principes. Max Weber lui-même souligna que l'expérience historique avait prouvé plus d'une fois l'impossibilité pour l'homme d'arriver au possible s'il n'avait pas cherché au préalable à atteindre l'inaccessible. Lorsque la gauche française accéda au pouvoir, elle n'abandonna pas pour autant les ambitions milléna- 1. Paul Nizan : Aden Arabie (préface de J.-P. Sartre), Maspero, 1971, p. 18.
ristes grâce auxquelles elle avait mobilisé sa base, même si, bien sûr, 1'« éthique de la responsabilité » devrait dorénavant baliser sa marche et ses actions. Les contraintes quotidiennes de l'adminis- tration n'interdisaient pas nécessairement de prendre des décisions qui auraient valeur d'exemple, décisions qui marqueraient un peu plus la présence de la gauche dans l'histoire de France. Cela dit, quelque subtile que soit la dialectique, le danger existait que, tels les puritains qui, en cherchant à vénérer Dieu avec plus de ferveur, trébuchèrent sur les fortunes du négoce et garantirent l'essor du capitalisme, la gauche administrerait un État bourgeois plus souvent qu'elle ne transformerait la société et le monde.
Le danger découlait de quatre sources. Tout d'abord, le fait que le pouvoir soit relatif. On a scrupule à énoncer un tel truisme mais, lorsqu'on ne cesse de s'y cogner, une porte ouverte n'est pas moins douloureuse qu'une autre. Le pouvoir, c'est aussi la force de résistance que l'on peut faire céder et, pour la gauche, il y avait loin de la victoire électorale à la transformation sociale : battre la droite un dimanche soir de miracle ne faisait pas disparaître le capitalisme à l'aube du lundi qui suivait. Censé incarner la volonté et l'autorité de la gauche, l'État aurait à surmonter toutes sortes d'oppositions intérieures et internationales.
Il ne fut pas toujours assez fiable ou assez fort pour suffire à la tâche. Cela explique en partie ce que la gauche fit, et pourquoi, plus d'une fois, elle ne put faire davantage.
La différence entre les promesses de la gauche dans l'opposi- tion et ses prouesses au pouvoir a été en partie seulement le résultat d'obstacles institutionnels, économiques et internationaux.
Lorsque les engagements pris n'ont pas été tenus, ce fut souvent moins en raison de complots ourdis par les adversaires que de promesses trop abondantes ou de déterminations trop frêles. Le mécontentement était de toute façon inévitable dès lors que les espoirs avaient été disséminés plus vite que les moyens de les satisfaire. Mais il serait injuste d'imputer la responsabilité exclusive de ce déséquilibre aux dirigeants socialistes et communistes.
Lorsque l'historienne américaine Lynn Hunt parle d'une « interac- tion explosive entre idées et réalités, intentions et circonstances,
pratiques collectives et contexte social1 », il importe de ne pas oublier la nature et la puissance des aspirations populaires : une
« soif de revanche » l'a souvent emporté sur une appréciation
« raisonnable » des incertitudes financières. Paradoxalement, de nombreux électeurs allaient critiquer la gauche pour ne pas avoir tenu toutes ses promesses alors qu'ils n'auraient jamais voté pour des candidats qui n'auraient promis que ce qu'ils pouvaient tenir.
Le propre des politiques gouvernementales, c'est qu'elles échouent souvent. Dès lors, plutôt que de s'interroger sur les raisons de ratages qui n'ont rien d'exceptionnel, il importe de voir ce que la gauche peut faire lorsqu'elle se trouve confrontée à l'échec de son programme initial. Sa tendance naturelle est d'agir comme le prisonnier qui, dans le noir, se rue vers la première lueur entrevue. Ce n'est pas forcément la plus susceptible de lui restituer sa liberté ; elle peut même l'attirer sur le terrain où l'attend l'adversaire. Pour la gauche française, il y eut là presque toujours un problème clé. Elle ne pouvait guère arriver au pouvoir avec une panoplie de mesures de rechange utilisables en cas d'échec des réformes sur lesquelles elle fondait sa nouvelle politique. Il aurait été paradoxal d'assortir de trop de roues de secours un programme de changement dont on avait maintes fois certifié qu'il tiendrait la route. Ainsi, lorsque la panne eut lieu, elle obligea à improviser des réparations de fortune, à réduire l'allure et à faire machine arrière. Le résultat de ce bricolage en catastrophe ne pouvait être que triplement négatif : perte d'autorité (ceux qui ont déjà reculé peuvent reculer encore), perte de crédibilité (ceux qui ont déjà échoué en dépit de leur programme prétendument parfait risquent d'échouer encore, maintenant que celui-ci est couvert de rustines collées à la hâte), et enfin perte d'élan (l'enthousiasme se fatigue lorsque les promesses sont revues à la baisse).
Le rôle des responsables politiques devient plus décisif encore quand le pilote automatique du programme de gouvernement a cessé de fonctionner. Il va falloir choisir vite entre des options dont aucune n'est encourageante et avec la conscience que toute nouvelle erreur pourrait se révéler fatale. Dans son livre sur les 1. Lynn Hunt : Poli tics, Culture and Class in the French Révolution, University of California Press, 1984, p. 13.
partis politiques, Robert Michels a reproché aux responsables de la gauche d'appartenir à une classe professionnelle qui se laisse absorber par l'État 1. Lorsqu'ils sont au pouvoir, ces responsables ont tendance à vouloir faire leurs preuves de ministres compétents et à solliciter le soutien de leurs fonctionnaires plus souvent qu'ils ne sont soucieux de tenir leurs engagements électoraux et de satisfaire leurs militants. Pour un ministre des Finances de gauche, un article louangeur dans le Wall Street Journal vaut toutes les ovations de congrès socialistes. Or on ne suscite pas le premier en menant la politique qui enthousiasme les seconds. Ce tiraillement entre deux clientèles est encore plus manifeste lorsque le programme initial de la gauche doit être réajusté. Les promesses faites dans l'opposition prennent alors des allures de fardeau, et ce sont les fonctionnaires du ministère qui semblent venir à la rescousse, les bras chargés de ces projets qu'ils n'avaient pas eu le temps de faire parapher par les ministres de droite chassés du pouvoir. Par ailleurs, vu des palais officiels, le moyen de résoudre certains problèmes est d'empêcher qu'ils soient soulevés par des voix non
« expertes ». Une dénonciation de l'« irresponsabilité » sert alors à camoufler une préférence pour la tranquillité administrative. Si cette préférence n'équivaut pas vraiment à une « trahison », elle a tout de même peu de chose à voir avec le type de transformation fondamentale promis avant la victoire. Les passions ne sont pas des administrés commodes.
Lorsqu'en étudiant la gauche française au pouvoir on souhaite laisser de côté les postulats généraux, encore que ceux-ci importent, pour s'attacher à une approche plus précise des difficultés à surmonter, une évolution apparaît à la fois frappante et banale.
Au fil du temps, la France s'insère dans une matrice historique qui met en cause les normes de souveraineté, de simplicité et de contrôle. L'évolution est banale parce qu'elle fait partie d'un phénomène universel qui a été si souvent souligné qu'on a scrupule à le rappeler : les observations pâteuses sur l'interdépendance d'un monde qui change appartiennent presque au répertoire de la satire politique. Mais, puisqu'il s'agit de la gauche française, le lieu commun recouvre un vrai problème. Car le programme grâce auquel elle mobilisait sa base avait une cohérence et une simplicité
1. Robert Michels : Les Partis politiques, Flammarion, 1971.
qui présupposaient la possibilité pour la France de prendre seule toute une série de décisions « stratégiques » et d'utiliser ensuite un système de commande fiable qui permettrait d'en garantir l'exécution. Mais si, au niveau international, le faisceau de l'indépendance se resserre alors même que, sur le front intérieur, la faculté de contrôle se réduit, c'est toute l'architecture d'une gauche jacobine qui vacille. Les théories ne peuvent pas être justes si elles postulent la simplicité d'un monde qui se diversifie et elles seront d'autant plus fausses que le pays dont elles proviennent se découvrira de plus en plus imbriqué dans ce monde. Face à une gauche française souvent un peu fanfaronne, parfois un peu inquiétante, ce monde, en général gouverné par des conservateurs, ne débordera pas de bienveillance. Il ne suffit plus alors de dire que le propre des politiques gouvernementales, c'est qu'elles échouent. Il faut ajouter que l'interdépendance renchérira le coût de chaque erreur. Et comme la coalition qui, des décennies entières, a rongé son frein dans l'opposition n'est pas particulière- ment encline à mettre l'accent sur les limites de ce qu'elle pourrait faire au pouvoir, c'est après la victoire que ces limites elle les découvrira. Plus la victoire se fera attendre, plus dure sera la chute.
La diversification sociale contredit les thèmes de la gauche un peu comme l'interdépendance met en échec ses ordonnances.
Lorsque les socialistes et les communistes accèdent au pouvoir, c'est en général qu'ils ont réussi à se présenter comme les interprètes d'une coalition majoritaire d'exploités désireuse de récupérer la part de la richesse nationale qui lui a été subtilisée par un petit groupe de possédants : « les deux cents familles » en 1936, « les gens du château » en 1981. Mais ce qui fait la trame de discours applaudis ne décrit pas précisément les contours de la structure sociale. La communauté d'objectifs qui est censée rapprocher ouvriers, paysans, employés et petits patrons ne correspond guère à ce que ces groupes éprouvent l'un pour l'autre : plus la coalition s'élargit, moins elle devient cohérente. Au demeurant, la tendance à la spécialisation qu'accélère le déclin du modèle fordiste désagrège ce que la gauche a besoin d'imaginer uni : le monde ouvrier. La probabilité d'une grande bataille aux contours tranchés s'éloigne alors, les clivages se multiplient, les petites querelles se généralisent, la décomposition opère à l'intérieur
de son propre camp au moins autant que chez l'adversaire. Cette diversification qui atténue la polarisation politique contribue à une approche plus graduelle du changement social, approche que la gauche, nourrie par une longue tradition de métaphores radicales, a eu beaucoup de mal à accepter. La montée des classes moyennes qui sont devenues plus conservatrices au fur et à mesure qu'elles gagnaient du terrain ne lui a pas facilité les choses.
Les problèmes nés de l'interdépendance et de la diversification sociale ne pouvaient être résolus que de deux manières : soit un virage brutal vers le réformisme, soit une approche volontariste agglomérant les particules sociales qui prenaient le large. L'histoire de la gauche au pouvoir offrira maintes occasions d'examiner les chausse-trappes de la première stratégie. Il vaut alors la peine de s'arrêter un instant sur la tentation activiste. En termes pratiques, elle impliquait l'utilisation de l'État, le contrôle par la puissance publique des éléments susceptibles de contrecarrer ses desseins.
Pour les responsables de la gauche, cette approche présentait l'avantage d'ouvrir une issue aux difficultés qu'ils allaient rencon- trer, issue qui serait autre chose qu'une capitulation en rase campagne. Ce système de pensée correspondait d'ailleurs à la forme de marxisme un peu rudimentaire qui s'empara de la gauche française dès lors que le socialisme utopique de Fourier ou de Proudhon en fut évincé. Voir en l'État l'agent du changement semblait être justifié par des arguments à la fois théoriques et pratiques. Mieux encore, cela ne déparait pas la tradition centralisatrice de la France. Une politique combinant nationalisa- tions et protectionnisme ne pouvait donc qu'être populaire à gauche. Elle y était perçue un peu comme une prophylaxie immunisant contre les germes conservateurs secrétés par la société et par le monde. De son côté, la droite ne se faisait pas faute d'exprimer ses craintes, réelles ou exagérées, d'une évolution totalitaire, d'un État boulimique qui avalerait tout ce qui lui ferait obstacle à l'intérieur, en même temps qu'il bouclerait le pays derrière une ligne Maginot de restrictions commerciales. Noter la récidive des soupçons, d'André Tardieu à Jean-François Revel \ c'est aussi souligner à quel point ils ont inhibé la gauche : elle s'est souvent montrée plus libérale que les gouvernements libéraux
1. Voir Jean-François Revel : La Grâce de l'État, Grasset, 1981.
qu'elle remplaçait. Ensuite, elle se l'est reproché en élaborant un programme qui garantirait, cette fois c'était promis, son contrôle des hauteurs de l'économie. Enfin, elle a recommencé à avoir peur de faire peur. Vu de loin, le ballet ne manquait ni de rythme d'ironie. La droite soupçonnait les socialistes et les communistes d'élaborer l'avènement d'un système qui garantirait à perpétuité leur maintien au pouvoir. La gauche pressentait que les conserva- teurs lui avaient laissé un terrain miné sur lequel elle ne pourrait se mouvoir sans ces « réformes de structure » q u ' o n prétendait lui interdire. A l'effroi d ' u n « voyage sans billet de retour » répondait le ressentiment du « mur d'argent ». Les enjeux de la compétition ont été élevés et le débat institutionnel passionné parce qu'ils ont impliqué, aux travers des règles du jeu, la peur de chacun des camps d'être indéfiniment exclu du pouvoir.
Même si l'on écarte les frayeurs exagérées de la droite, il ne fait pas de doute que le renforcement de l'État a constitué pour la gauche un choix et une nécessité, ne serait-ce que pour acquérir les moyens d'une nouvelle politique, ce que Mendès France appelait
« un État fort face à l'argent fort ». En théorie, la question de savoir si l'« État bourgeois » devait être détruit ou pouvait être utilisé n'est pas sans importance pour un marxiste, mais en pratique les marxistes français avaient décidé d'ignorer l'avis sans ambiguïté de Karl Marx dans son analyse de... la Commune de Paris ! La révolution n'étant pas à l'ordre du jour avant une longue « transition », l'« État bourgeois » serait utilisé pour transformer la société bourgeoise. Ce choix détermina une certaine dépendance par rapport à des hauts fonctionnaires que leurs préférences politiques et leur expérience pratique rendaient peu réceptifs aux nouvelles orientations du pouvoir. Certes, ces admi- nistrateurs se trouvaient placés sous le contrôle du gouvernement et ne devaient en principe jouer q u ' u n rôle technique. Mais la neutralité de la fonction publique est souvent fictive : l'administra- tion détermine les termes du débat tant nombre de décisions ministérielles sont en germe dans les « petites notes » des conseil- lers. Inutile à vrai dire de trop insister sur l'influence des fonctionnaires. Max Weber a fait de la « connaissance supérieure de l'expert bureaucratique » et de l'« impuissance relative du maître politique1 » deux des composantes décisives de la marche
1. M. Weber : op. cit., p. 234.
du temps, de la rationalisation du monde et du « désenchantement de l'univers ». Cette aurore-là, cela s'appelle peut-être la fin de l'état de grâce.
Contrainte d'accorder à l'administration un pouvoir discré- tionnaire étendu, la gauche ne pouvait pas ignorer que, aux yeux de certains hauts fonctionnaires, elle faisait à la fois figure de dilettante et d'oiseau de passage. Cependant, compte tenu de l'accélération technologique, ces administrateurs rétifs ne pouvaient être maintenus sous tutelle. Ce qui est vrai du travailleur à la chaîne, qui est aujourd'hui bien autre chose que le « gorille intelligent » imaginé par le père du taylorisme, l'est aussi pour le fonctionnaire de base. Il devint de plus en plus inconcevable d'anticiper tous les problèmes auxquels il pourrait faire face et de prescrire toutes les réponses qu'il devrait y apporter. Les dirigeants de la gauche, même s'ils cherchaient à recentraliser le pays, ne pouvaient sérieusement escompter devenir à la fois décideurs au ministère de la Défense, à la préfecture d'Alsace et à la division commerciale de Renault. L'obligation de déléguer s'est avérée de plus en plus insistante à mesure qu'on s'éloignait du schéma de la révolution industrielle et de ses grosses machines entreposées dans des grosses usines financées par des grosses banques, l'ensemble inspiré et organisé d'en haut et du centre.
Les dissonances ne furent pas seulement le produit d'une malveillance politique ; parfois l'instinct de survie l'emporta sur la tentation du sabotage. Car personne ne pouvait évaluer avec précision la durée pendant laquelle la gauche se maintiendrait à la direction des affaires, à la réserve près que, jusqu'en 1981, les antécédents ne portaient pas à parier sur la longévité. Dès lors, surtout dans le contexte né de la confrontation tranchée entre droite et gauche, il ne paraissait guère habile de servir avec trop de zèle ou de savoir-faire un gouvernement condamné à devoir sous peu céder la place à ses adversaires. Dans le système français, les fonctionnaires ont déjà tendance à voir en leurs supérieurs politiques des quartiers-maîtres en transit. L'idée d'obtempérer aussitôt à leurs consignes, en particulier lorsque celles-ci semblaient
« irresponsables » et en instance d'être contredites, ne s'est pas toujours imposée comme une aveuglante nécessité. Cependant, avant de déduire de ce qui précède qu'il fut impossible à la gauche de gouverner lorsqu'elle régna, il ne faut pas oublier que les
fonctionnaires ont un peu trop souvent vocation à devenir les boucs émissaires des politiques qui échouent.
Mais, puisqu'il s'agit de la gauche, l'étude de l'État et des questions d'efficacité, de fiabilité et de durée ne doit pas occulter la dimension complémentaire du problème, qui a trait à la mobilisation populaire et à la société civile. La question de savoir ce qu'il advient des mouvements sociaux lorsque la gauche chevauche leur élan jusqu'aux grilles du pouvoir importe bien plus que dans le cas de la droite, dont la base électorale et militante est en général plus indolente ou plus circonscrite. Dans un contexte transformé par la mobilisation populaire, utiliser l'État pour changer la société présente un risque évident. Il est difficile de combiner l'administration tutélaire qu'impose un gouvernement activiste et la démocratie participative que suppose un pouvoir de gauche : en réalité les notions de réforme issue du sommet et d'innovation venue de la base sont contradictoires plus souvent qu'elles ne sont synergétiques. Il serait donc injuste d'imputer à l'indifférence des masses en matière de pratique démocratique la responsabilité exclusive de la dérive bureaucratique qui caractérisa nombre de gouvernements de gauche. La résignation populaire à l'idée de laisser les responsables gouverner fut souvent encouragée par ces responsables eux-mêmes. Une fois au pouvoir, ils n'ont rien fait pour empêcher que se généralise la croyance que l'implication de la base serait à la fois inutile et perturbante. Une révulsion de type léniniste a salué tout mouvement spontané, immanquablement condamné comme gauchiste ou provocateur lorsqu'il s'est révélé non récupérable. Il faut alors évaluer avec beaucoup de scepticisme les lamentations rétrospectives des respon- sables de la gauche qui ont imputé leur échec à l'absence de soutien de leur base et à l'isolement dans lequel cette désertion les aurait plongés. Comptant sur l'État et cooptée par l'administration, la gauche n'allait pas être en mesure d'imprimer un virage démocratique. Et sans ce virage, l'impulsion et la force nécessaires à la remise en cause du statu quo, à l'incandescence de la « nuit glacée », lui feraient à coup sûr défaut.
La gauche accéda au pouvoir grâce à la puissance des passions politiques qu'elle avait invoquées. Bientôt elle accepta de tamiser ces passions avant de les étouffer sous une couverture de rationalité technique. Cette retraite bureaucratique, cette nouvelle conscience
qui ne voit dans le monde que moyens et machine, constitueraient les barreaux de sa cage de fer.
Il faut maintenant aller au-delà d'une problématique générale qui insiste sur la tension entre un discours propre à mobiliser les masses et une pratique de gouvernement qui conduit à les décevoir puis à les faire taire. Si la contradiction fut presque toujours douloureuse, c'est que le mal était presque toujours inévitable.
Tel le Sisyphe de Camus, la gauche française a longtemps été condamnée au « supplice indicible où tout l'être s'emploie à ne rien achever ». Vint un moment où elle en eut assez de sa lutte vers les sommets, de son rocher qui roule et de sa nuit sans fin.
Redescendue dans la plaine, elle s'y installa pour de bon.
Le choix de nos quatre tentatives d'escalade est discutable, bien sûr. Mais comment être absolument rigoureux ? Jusqu'en 1981, et à l'exception de quelques mois, entre octobre 1945 et juin 1946, les socialistes et les communistes n'ont jamais été en position de gouverner seuls. Il leur a fallu chaque fois partager le pouvoir avec des forces politiques qui camouflaient à peine leur modération en se prénommant « républicaines, radicales et radicales-socialistes ». Si cela explique les tensions qui ont traversé les coalitions de gauche, cela rend aussi plus difficile la définition de ce qu'est un gouvernement de gauche.
Faut-il que les communistes y participent ? Alors, on étudiera les ministères tripartites dirigés par de Gaulle au lendemain de la Libération mais pas ceux conduits par Léon Blum du temps du Front populaire. Faut-il qu'un socialiste soit en charge de l'exécu- tif ? Dans ce cas, on s'intéressera au Guy Mollet du Front républicain mais pas à l'Édouard Herriot du Cartel des gauches.
Faut-il que les députés socialistes appuient de leurs votes l'équipe au pouvoir ? Du coup, nombre de gouvernements de « troisième force » se métamorphosent et deviennent de gauche entre 1947 et 1951. Serait-ce alors le soutien des députés communistes qui constituerait la clé de tout ? Le Laurent Fabius de 1984, dont la politique s'écarta fort peu de celle de Pierre Mauroy après 1982, cesse d'avoir été un premier ministre de gauche.
En vérité, deux des quatre cas s'imposent sans trop de discussions, 1936 et 1981. Chaque fois, un socialiste dirigea un exécutif auquel le Parti communiste délégua ses ministres ou qu'il soutint sur le plan parlementaire. En dépit de la présence de Charles de Gaulle aux affaires de 1944 à 1946, les équipes de la
Libération font aussi à l'évidence partie du champ d'étude : gouvernements à participation communiste pour la première fois dans l'histoire de France, gouvernements qui mettent en route un programme sans précédent de réformes de structure (dont la nationalisation des secteurs clés de l'économie), gouvernements qui s'inscrivent dans un contexte exceptionnel tant il est marqué par la disparition politique — et provisoire — de la droite.
L'unité nationale de la Libération eut donc une coloration ultraprogressiste : le fait que la gauche occulte ses adversaires au point d'occuper tout le terrain ne l'empêche pas d'exercer un pouvoir de gauche.
Le cas de 1924 est certainement plus discutable. Non seulement le Parti communiste s'opposa au gouvernement d'Édouard Herriot, auquel les socialistes ne participèrent pas, mais encore le Cartel ne promit aucune réforme de structure — ce qui correspondit exactement au nombre de celles qu'il réalisa. Cependant, le Cartel des gauches est intéressant pour trois raisons. D'abord, il parvint au pouvoir à l'issue d'une campagne électorale particulièrement polarisée, simple prélude de cette montée des passions politiques qui constitue souvent l'indice infaillible que l'ordre traditionnel apparaît en cause et que les intérêts économiques privilégiés se sentent menacés. Ensuite, on ne peut sous-estimer le fait que 1924 marqua le premier engagement officiel du Parti socialiste aux côtés d'une équipe au pouvoir en temps de paix, engagement motivé par un programme qui, s'il n'était pas radical, était tout de même progressiste et, à ce titre, violemment combattu par la droite. Il serait d'ailleurs maladroit d'exagérer la signification de l'opposition communiste au Cartel des gauches : à l'époque, le Parti communiste faisait ses premiers pas dans un berceau ultrasectaire et il n'aurait jugé digne d'attention qu'un remake de la prise du palais d'Hiver. La dernière raison est peut-être la plus importante, encore qu'elle soit la plus difficile à appréhender avec rigueur. Dans son livre La Gauche en France depuis 1900, Jean Touchard a insisté sur l'importance des traditions et des symboles :
« Aucune gauche au monde n'a derrière elle un pareil ensemble de souvenirs et de références'. » Or, en dépit de l'échec éclatant du Cartel, qui aurait plus que justifié qu'on en ensevelît le
1. Jean Touchard : La Gauche en France depuis 1900, Le Seuil, 1977, p. 17.
souvenir, la tentative d'Herriot ne fut pas oubliée. Elle avait offert à la gauche sa première leçon de pouvoir. Celle des obstacles auxquels elle devrait faire face et des espérances qu'il lui faudrait décevoir. D'autres exemples de maladresses en face du « mur d'argent » et de retraites devant la pression conservatrice suivraient, mais, comparés à la débâcle de 1924-1926, ils prendraient presque des allures d'épopée. Après tout, peut-être que la place du Cartel dans la symbolique de la gauche au pouvoir tient à ce qu'il représenta une « expérience » si facile à égaler qu'elle rendrait d'autant plus indulgente l'appréciation des étapes suivantes. Mais puisqu'il en faudra, de l'indulgence, alors va pour le Cartel !
Une caractéristique commune rattache les quatre cas évoqués.
Chacun pourrait être décrit comme un bref bain de soleil suivi d'une longue souffrance, le tout aboutissant au retour de la droite.
C'est sans doute de là que vient l'épithète d'« expérience » dont on a affublé les gouvernements de la gauche, un peu comme s'il s'était agi avec eux d'une récréation entre deux classes studieuses, peut-être utile parce qu'elle permettait de se dérouiller les jambes, mais peu susceptible de représenter un comportement durable, et dès lors nécessairement interrompue par le sifflet d'un maître de droite sous l'autorité duquel le vrai labeur reprendrait. On raconte ses vacances plus souvent que son travail, et c'est aussi pour cela qu'en dépit de leur brièveté chacun des passages de la gauche au pouvoir a évoqué des souvenirs durables et passionnés.
En fait, de manière un peu romantique, plus court fut le passage, plus brillant fut son souvenir que les compromis n'avaient pas eu le temps de ternir. Dans le panthéon de la gauche française, le héros dont communistes et socialistes se disputent encore les dépouilles est un homme, Jean Jaurès, qui ne gouverna jamais.
Et il est vraisemblable que François Mitterrand, alourdi du poids d'une présidence interminable pendant laquelle il épuisa la plupart des espoirs qu'il avait laissés naître, ne suscitera pas les commémo- rations émues qui entourent aujourd'hui encore les gouvernements précaires de Léon Blum et de Pierre Mendès France.
L'importance centrale de la mémoire, des perceptions et de l'histoire explique pourquoi une référence à 1924 ou à 1936 permet souvent de comprendre les épisodes qui suivent. Ce n'est pas seulement que les précédents ont parfois soulevé les mêmes problèmes de fond, c'est aussi que leur souvenir est resté vif dans l'esprit des dirigeants de la gauche française, plus susceptibles que
d'autres de penser de manière historique, de vouloir appartenir à une tradition, ou de chercher à éviter la récidive. Dans son traité de théorie des organisations, Herbert Simon a parfaitement exprimé les problèmes nés d'un pavlovianisme historique dont découlèrent r mbre des difficultés de la gauche au pouvoir : « Une fois qu'une habitude a été acquise, la simple présence d'une stimulation suffit à déclencher le comportement habituel, sans que la réflexion intervienne. Dans des circonstances de ce type, une attention particulière peut être nécessaire pour prévenir la réponse automati- que que des circonstances différentes auraient rendue inap- propriée 1. » Pacifiste en 1936 pour ne pas refaire l'erreur de 1914 et de son exaltation d'une guerre « fraîche et joyeuse », baroudeuse à Suez et au Koweit pour ne pas se faire imputer un « nouveau Munich », keynésienne et dirigiste en 1981 pour répéter les précédents perçus comme encourageants de 1936 et 1945 ; nom- breux sont les exemples de stimulations malheureuses. L'erreur de 1936 fut d'assimiler Hitler au Kaiser ; celle de 1956 de comparer Nasser à Hitler ; celle de 1981 d'espérer que l'industrie française bénéficierait d'une relance de la demande intérieure alors qu'elle était mal en point et que les frontières restaient ouvertes aux produits étrangers.
Ici, il est toutefois nécessaire d'aller au-delà d'une critique du passéisme pour s'intéresser aux motivations des critiques. Car souvent le discours politique mettant l'accent sur la « modernité » et le « changement » — un discours lui-même fort ancien — a servi de camouflage à peine transparent au désir d'effacer tout ce qui représentait la spécificité et l'identité de la gauche française.
Marcel Déat reprocha à Léon Blum son archaïsme ; Michel Rocard fit de même avec François Mitterrand ; Laurent Fabius se voulut plus moderne que Pierre Mauroy. Débarrassés de toute référence encombrante, nombre de réformateurs pusillanimes se trouvèrent plus libres de passer un compromis ou d'opérer une jonction avec l'idéologie, les politiques et les positions de pouvoir offertes par la droite. L'impatience des modernes auto-proclamés qui ont voulu transformer la gauche eut souvent moins à voir avec la nature dogmatique du discours socialiste qu'avec le contenu socialiste du prétendu dogme. A travers l'histoire contemporaine, des innova-
1. Herbert Simon : Administrative Behavior, New York, The Free Press, 1976, p. 89.
teurs de gauche n'ont eu de cesse de recycler la modernité du marché, de la fin de la lutte des classes, et de la découverte de l'entreprise. Les deux courants de pensée (« doctrinaire » contre
« opportuniste ») et les deux types d'acteurs (« anciens » contre
« experts ») ne se sont d'ailleurs pas contentés de coexister à l'intérieur de la gauche française ; ils se sont également succédé aux commandes du pouvoir. Si on laisse de côté le Cartel des gauches, à la médiocrité uniforme, on découvre presque toujours l'alternance d'une période euphorique, pendant laquelle la gauche rejoue les grands actes de son passé, et d'une phase désenchantée au cours de laquelle, une fois les vieux symboles épuisés, elle ravaude d'une crise à l'autre, s'inspire de plus en plus des pratiques de la droite et justifie ses embardées idéologiques par la « fin des idéologies ». Le socialisme qui en rabat succède au socialisme qui en impose. Avant, le défi à relever, c'était de faire du pays un
« nouveau modèle de civilisation ». Bientôt, ce sera d'avoir été le
« grand normalisateur ». Anatole France l'écrivait déjà à propos de la Révolution : « A l'enthousiasme de la première heure succédait l'indifférence générale1. »
Jusqu'en 1981, chaque échec romantique de la gauche a pu être exorcisé grâce à une relecture un peu paranoïaque de l'histoire : trahison du « mur d'argent » en 1925, subversion des élites qui, en 1937, préfèrent Hitler au Front populaire, éviction du Parti communiste et guerre des gauches imposées par Washington en 1947. La présidence de François Mitterrand aura eu au moins l'avantage de mettre en relief les causes endogènes expliquant l'échec de l'« expérience » : ambition du programme, défauts de la stratégie économique, assimilation excessive de la voloncé politique et de l'action étatique. Cela ne revient pas à dire que des motifs exogènes, qu'ils soient intérieurs (la droite) ou internationaux (les contraintes commerciales et les pressions diplomatiques) n'ont pas joué leur rôle. Mais ces obstacles ne suffisent pas à expliquer l'ampleur de la déception. Le cas de 1981 a donc obligé la gauche à examiner autre chose que ses boucs émissaires familiers, et ce d'autant plus qu'elle décida d'elle- même de reconsidérer ses perspectives économiques et sociales.
Loin d'imputer son recul à des pressions malignes, refusant même de parler de « pause » précédant un second train de réformes, les
1. Anatole France : Les dieux ont soif, Calmann-Lévy, 1985, p. 42.